Baba Yaga
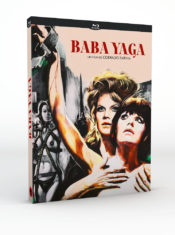 Italie, France : 1973
Italie, France : 1973
Titre original : –
Réalisation : Corrado Farina
Scénario : Corrado Farina, Guido Crepax
Acteurs : Carroll Baker, George Eastman, Isabelle De Funès
Éditeur : Le Chat qui fume
Durée : 1h22
Genre : Fantastique, Érotique
Date de sortie Blu-ray : 30 novembre 2021
À Milan, dans les années 1970, la photographe de mode Valentina Rosselli croise un soir dans la rue une femme belle et mystérieuse, tout de noir vêtue, répondant au nom étrange de Baba Yaga. Cette rencontre engendre chez Valentina des rêves bizarres où se mêlent luxure et sadomasochisme, puis des incidents inexplicables provoqués par son appareil photo, sur lequel Baba Yaga semble avoir jeté un sort. Peu à peu, cette dernière parvient à tenir la jeune photographe sous son emprise, et seul son ami Arno Treves paraît en mesure de la délivrer du pouvoir maléfique de la sorcière…
Le film
[4/5]
Baba Yaga se situe pile au carrefour entre deux légendes.
D’un côté, nous avons Guido Crepax (1933-2003), véritable référence au sein de la bande dessinée italienne : son rayonnement et son influence sur le neuvième Art ont en effet largement dépassé les frontières de l’Italie, et ont profondément marqué la bande dessinée européenne de la seconde moitié du XXe siècle. Spécialiste de l’érotisme et des adaptations littéraires, Crepax aura au fil de sa carrière aussi bien illustré Dracula et Frankenstein qu’Emmanuelle ou Justine de Sade, mais le personnage qui marquera le plus les mémoires sera celui de Valentina, créé en 1965, héroïne ayant vécu de nombreuses aventures jusqu’en 1993. En France, les bandes dessinées Valentina, caractérisées par une ambiance psychédélique et onirique saupoudrée d’érotisme, furent notamment publiées dans Hara-Kiri et Charlie Mensuel.
De l’autre côté, nous avons donc le personnage de Baba Yaga. Personnage récurrent du folklore russe, il s’agit d’une sorcière ayant acquis, au fil des siècles, une aura maléfique ayant également largement dépassé les frontières des pays slaves : on trouve même une référence à ce personnage de « croque-mitaine » dans la saga John Wick. Le film de Corrado Farina choisit donc de mettre en scène la rencontre entre ces deux personnages, symboles de deux imaginaires très marqués. Mis en boite en 1973, Baba Yaga s’impose également comme le pur fruit de son époque, dans le sens où les bandes dessinées italiennes ou Fumetti avaient la côte à la fin des années 60 / début des années 70, et se voyaient très régulièrement mis à l’honneur au cinéma.
Terrain d’expérimentation au carrefour de tous les Arts populaires de l’époque (BD, roman photo, littérature « de gare »…), le cinéma d’exploitation se régalait en effet à l’époque de mélanger les genres, les tonalités et les délires formels les plus saugrenus. Le film le plus représentatif de la folie douce de cette époque est probablement le sublime Danger : Diabolik de Mario Bava (1968), mais on a déjà abordé dans nos colonnes beaucoup de films se rattachant au genre, tels que le formidable Opération Re Mida de Jess Franco. Même s’il verse bien d’avantage dans l’érotisme que ses équivalents évoluant dans le domaine de l’aventure ou de l’espionnage, Baba Yaga s’avère également un fier représentant de cette époque.
Pour le rôle de Valentina, héroïne de Baba Yaga, Corrado Farina opte pour Isabelle De Funès, nièce de l’acteur français bien connu – une actrice intéressante ayant eu une très courte carrière dans les années 70. Elle incarnera donc à l’écran le personnage créé par Guido Crepax : elle adopterait d’ailleurs pour l’occasion la coupe à la Louise Brooks que le personnage arborait également dans les bandes dessinées. Sa silhouette filiforme est également assez fidèle au trait du dessinateur, qui aimait les sacs d’os : on pourra retrouver son héritage dans les dessins d’un auteur tel que Milo Manara, qui deviendrait un des grands noms de la BD érotique au début des années 80, parallèlement à Paolo Eleuteri Serpieri, qui quant à lui privilégiait des héroïnes nettement plus plantureuses.
Mais revenons au film : Valentina est donc une photographe à succès, travaillant dans le milieu de la mode à Milan. Un soir, elle se fait raccompagner par une bourgeoise au volant d’une voiture de luxe, qui se trouve être la fameuse Baba Yaga du titre. La sorcière est incarnée par Carroll Baker, que l’on a récemment vue chez Le Chat qui fume dans le très beau giallo Le couteau de glace. Après que Baba Yaga lui ait emprunté un de ses porte-jarretelles, Valentina commence à faire d’étranges rêves érotiques. Le lendemain, la sorcière jette un sort à l’appareil photo de Valentina et l’invite à se rendre chez elle. La désorientation de la photographe ne fera dès lors que s’accentuer, le rêve et réalité se superposent de plus en plus dans son esprit. Ses visions se font de plus en plus dérangeantes (violence, nazis, femmes à poil) et son appareil se met à tuer ceux qu’elle prend en photo.
La première victime de cet appareil photo maudit – un jeune participant à une manif post-68 – permet par ailleurs, mine de rien, à Corrado Farina d’ébaucher un début de réflexion sur la société italienne de l’époque, et sur le conflit des générations. Cette opposition entre les jeunes libertaires des années 70s et la génération de leurs parents, doublée du spectre pas si lointain de la guerre (représentée dans Baba Yaga par les soldats nazis ainsi que, par extension, par la maîtresse dominatrice incarnée par Ely Galleani), se retrouve évidemment également au cœur même de Baba Yaga, à travers le binôme formé par Valentina et la sorcière, qui représentent à leur manière la modernité et la fougue de la jeunesse s’opposant au poids des traditions.
Ce contraste entre la fougue de la génération 70’s et l’austérité du passé est également mise en place par Farina d’un point de vue formel, dans le sens où dans sa deuxième partie, Baba Yaga recycle certains codes du cinéma d’épouvante gothique à travers la grande demeure de la sorcière, sombre et majestueuse, mais en état de délabrement avancé : portes qui grincent, planchers troués, vieux meubles poussiéreux, donjon aux tendances SM… Baba Yaga mélange ainsi des éléments du cinéma gothique classique et de la culture pop psychédélique de la fin des années 60.
Ces contrastes nets contribuent à rendre Baba Yaga fascinant, en dépit de son rythme lent. La narration est déroutante, les dialogues échangés entre les deux personnages principaux semblent comme tirés d’une mécanique de rêve ou d’écriture automatique, tandis que le personnage d’Ely Galleani ne parle pas du tout. Quelques ellipses sont également de la partie, ce qui ne manquera pas de laisser vagabonder l’imagination du spectateur. Cette narration floue, constamment sur la corde raide, s’impose cependant comme l’un des points forts de Baba Yaga. Certaines séquences du film, longues et magnifiquement filmées, ressemblent à des rêves sous acide, mais se voient contrebalancées par d’élégantes séquences érotiques. L’atmosphère et l’intensité qui se dégagent du métrage est assez unique, d’autant qu’elles se voient encore renforcées par une bande sonore exceptionnelle signée Piero Umiliani (L’île de l’épouvante).
Les acteurs sont par ailleurs excellents, d’Isabelle De Funès à Carroll Baker, en passant par George Eastman (Anthropophagous), qui déboule un peu de nulle part dans la narration, mais marque comme d’habitude le film de son empreinte. Une belle découverte.
Le Blu-ray
[5/5]
Le Blu-ray de Baba Yaga édité par Le Chat qui fume, disponible chez tous les meilleurs dealers de culture depuis trois semaines, s’impose dans un packaging grande classe dans la droite lignée des remarquables éditions proposées par l’éditeur depuis 2017. Le film de Corrado Farina est proposé dans un superbe digipack trois volets garni d’un sur-étui, dont la conception graphique est assurée, comme d’habitude, par Frédéric Domont. On ne se lassera jamais de répéter à quel point la présentation des galettes éditées par Le Chat est parfaite : un grand bravo à Stéphane Bouyer et Philippe Blanc pour la rigueur et la passion dont ils font preuve depuis de nombreuses années maintenant, et qui a permis au Chat de devenir « LE » meilleur éditeur français du monde entier de l’univers. Comme d’habitude avec l’éditeur, ce premier pressage est limité à 1000 exemplaires.
Côté Blu-ray, Baba Yaga a vraiment de la gueule : le master Haute Définition du film est tout à fait resplendissant, et affiche une définition et un niveau de détail assez bluffants, tout en respectant scrupuleusement la granulation d’origine de la pellicule. L’image s’avère même étonnante par sa propreté (ni tâches ni poussières disgracieuses à l’horizon) et sa stabilité. Le rendu HD, qu’il s’agisse des couleurs ou des contrastes, semble avoir également bénéficié d’un soin tout particulier, et on ne trouvera aucune trace de DNR ou d’autres bidouilles numériques – tout juste regrettera-t-on un grain peut-être un poil trop accentué lors des passages nocturnes ou en basse lumière. Côté son, nous aurons droit à une piste DTS-HD Master Audio 2.0 en VO italienne – la clarté est de mise, et la musique de Piero Umiliani est parfaitement restituée. Du très beau travail technique !
Du côté des suppléments, comme d’habitude, Le Chat qui fume continue de nous proposer des suppléments riches et variés. On commencera donc avec un entretien avec Luigi Montefiori, alias George Eastman (11 minutes). Il y évoquera brièvement sa carrière en tant que comédien avant d’aborder le film à proprement parler. Il s’attardera un peu sur l’ambiance sur le tournage, sur ses relations avec Corrado Farina et les actrices, et reviendra sur la bande dessinée de Guido Crepax.
On enchainera ensuite avec un entretien avec Alberto Farina (45 minutes), au cœur duquel le fils du cinéaste évoquera longuement la bande dessinée de Crepax et son impact dans la culture populaire italienne, avant d’évoquer la vie et l’œuvre de son père. L’œuvre de Corrado Farina sera également au centre d’un entretien radiophonique avec le cinéaste (19 minutes), qui lui permettra de jeter un coup d’œil dans le rétro de sa carrière.
Mais ce n’est pas tout : Le Chat qui fume nous propose en effet de nous plonger dans une dizaine de minutes de scènes coupées, dans l’ensemble très courtes, mais souvent intéressantes. On terminera ensuite avec trois courts-métrages documentaires réalisés par Corrado Farina. Mon cher petit journal (11 minutes) retrace l’histoire d’un journal pour enfants à l’occasion de ses 60 ans, en la croisant de manière habile avec des images d’archives. BD Freudienne (12 minutes) revient quant à lui sur le poids « social » de la bande dessinée en Italie, en le croisant avec l’œuvre de Guido Crepax. Enfin, BDphobie (12 minutes) revient sur la portée « subversive » que peut avoir la bande dessinée, et l’impact qu’elle peut avoir dans la construction de la jeunesse. Guido Crepax y est à nouveau bien représenté. On terminera enfin avec la traditionnelle bande-annonce. Pour vous procurer cette édition indispensable, rendez-vous sur le site du Chat qui fume.

























